
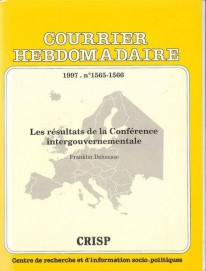 Agrandir l'image
Agrandir l'image Les résultats de la Conférence intergouvernementale
Courrier hebdomadaire n° 1565-1566,
par F. Dehousse, 53 p., 1997
Référence : CH1565-1566
En savoir plus
La complexité du traité d'Amsterdam résulte de plusieurs facteurs. A la différence de l'Acte unique de 1986 ou du traité de Maastricht de 1992, il n'existait pas un objectif politique clairement défini par une large majorité d'Etats membres. La Conférence intergouvernementale - CIG avait été réclamée en 1992 par certains d'entre eux pour compléter le traité de Maastricht, alors que d'autres ne souhaitaient pas voir se répéter les débats de ratification. Pour certains Etats membres, les négociations concernaient surtout les deuxième et troisième piliers. Pour d'autres, elles avaient essentiellement un objectif institutionnel, à savoir la réforme des institutions communautaires avant les prochains élargissements. Pour d'autres encore, comme la Belgique, elles visaient d'abord l'approfondissement de la construction européenne, à commencer par ses aspects économiques et sociaux. A ces revendications s'ajoutaient encore les appels multiples et souvent contradictoires des groupes de pression. Dans pareil contexte, atteindre l'unanimité des Etats membres, toujours exigée pour la révision des traités européens, constituait déjà un exploit. De plus, les négociations ont été compliquées par le maintien de la structure des piliers. Depuis le traité de Maastricht, l'Union européenne se compose de trois piliers. Le premier, de nature supranationale, regroupe les trois Communautés européennes (CECA, CE, CEEA). Les deux autres, de nature intergouvernementale, couvrent la politique étrangère et la sécurité intérieure (immigration, asile, coopération policière et judiciaire). Ne pas remettre en cause ce système a engendré de nombreux problèmes. Des matières parfois étroitement liées se trouvaient séparées de façon artificielle entre des systèmes administratifs différents. La structure des piliers stimule, en outre, les conflits bureaucratiques. Enfin, ce débat s'intégrait dans un ensemble de trois négociations: le lancement de la troisième phase de la monnaie unique, héritage du traité de Maastricht, la CIG elle-même, et les nouveaux élargissements aux pays d'Europe centrale et orientale. Si ces trois négociations se déroulaient dans des cadres distincts, elles avaient indéniablement des répercussions les unes sur les autres. Cette superposition explique également une volonté largement répandue d'achever rapidement la CIG, afin d'entamer sans engorgement les négociations concernant la monnaie unique et les nouveaux élargissements. En raison de tous ces éléments, le traité d'Amsterdam est fort modeste. S'il prévoit de nombreux changements, il ne réalise pas les réformes institutionnelles annoncées depuis longtemps. Dès lors, tout nouvel élargissement sans réforme institutionnelle préalable aboutira à l'abandon du projet politique européen lancé après la deuxième guerre mondiale. Par ailleurs, le traité d'Amsterdam est difficile à analyser. Pour donner ,une vision aussi structurée que possible de ses dispositions, nous évoquerons successivement les questions économiques et sociales, les problèmes de sécurité intérieure, la politique étrangère et les institutions. Nous tenterons alors d'envisager les conséquences à long terme du sommet européen d'Amsterdam.
Derniers livres parus
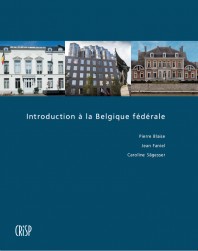
Introduction à la Belgique fédérale
12,00 €
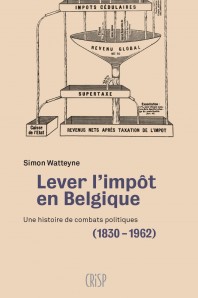
Lever l’impôt en Belgique. Une histoire de combats politiques (1830-1962)
35,00 €

Questions d’histoire politique de Belgique. Liber Amicorum Paul Wynants
20,00 €




